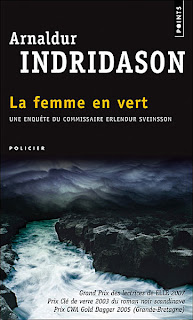Jacqueline Walls et
Jérémy Corbin sont parvenus à se poser, à mener ce qui ressemble
de loin à une vie relativement paisible après les événements
auxquels ils ont été confrontés avec Eytan Morgenstern depuis le
Projet Bleiberg. Jacqueline est devenue flic dans la ville du New
Jersey qu'ils habitent. Jérémy a rejeté son ancienne vie de trader
pour devenir libraire. Ils ont eu une petite fille. Rien a priori ne
devrait bousculer cet équilibre acquis de haute lutte mais d'autres
personnes en ont décidé autrement. De sorte qu'Eytan, qui ne veut
s'attacher à personne, va tout mettre en œuvre pour les protéger,
quitte pour cela à renouer une fois de plus avec son passé. Car ce
qui se trame aujourd'hui possède de sombres résonances avec l'objet
de sa lutte et la racine de ses propres souffrances...
Pas facile, sans doute de
continuer sur la lancée d'un Projet Bleiberg. Est-il possible de
tenir ainsi sur la longueur, faire en sorte que l'intérêt ne
s'émousse jamais ? Le Projet Shiro, deuxième volet des
aventures d'Eytan Morgenstern avait à lui seul levé le doute, et si
tant est qu'il soit réapparu, ce dernier tome le renvoie
définitivement dans les limbes. Certes, la mécanique est identique,
l'auteur alternant éléments du passé et temps présent. Certes,
les personnages et leurs particularités nous sont connus. Mais cela
n'enlève jamais, n'enlève en rien la faculté qu'a David S. Khara
de raconter l'Aventure, de la poser, la décomposer, de l'étirer, de
la rendre malléable au point d'en faire ce qu'il veut.
Cela tient parfois à peu
de choses. Certains vous parleront de style cinématographique, de
scènes très visuelles. Personnellement, je perçois dans cette
série de livres – et je peux me tromper naturellement - la somme
des influences que peut avoir l'auteur, que ce soit en matière de
livres ou même de films, et qui sonnent comme un écho incroyable
aux références que je colporte dans ma propre caboche. Cela s'avère
saisissant dans les scènes se passant pendant la seconde guerre
mondiale, en Pologne, lorsque Eytan rejoint les rangs d'un groupe de
résistants, qu'il lutte avec eux pour déjouer les plans des occupants. Et pourtant il ne s'agit pas non plus d'un simple copier
/ coller de références, car l'auteur a son style propre, un style
efficace, vif et... oui, imagé. Il a sa manière bien à lui de
poser son histoire, de dépeindre actions et situations. Mais
surtout, il connaît ses personnages, aime - cela se voit, se sent -
les faire évoluer selon des caractéristiques qui leur sont propres
sans pour autant les faire réagir de façon trop systématique à
tel ou tel événement donné. Ce sont à la fois des personnages de
fiction répondant aux codes du roman d'Aventure, avec ce qu'il faut
d'humour, de sérieux, de réfléchi et de faculté à réagir aux
embûches semées sur leur parcours, mais
ce sont avant tout des personnes en questionnement sur le monde qui
les entoure.
Côté questionnements,
justement, on n'est pas en reste avec le Projet Morgenstern. De ce
point de vue, l'alternance passé / présent, revêt toute son
importance. Parallèle miroir, elle renvoie la quête de l'Übermensch,
dont Eytan a été l'une des victimes, au transhumanisme, mouvement
qui tendrait à améliorer les capacités humaines grâce à la
science. Pas question en l'occurrence de jeter le progrès ou les
innovations à la trappe mais de mettre en garde contre les dérives
qu'elles ne manquent pas d'engendrer...
Vous l'aurez donc
compris, si vous manquez de Projets en ce moment, vous savez vers où vous tourner... ils sont disponibles dans toute bonne
librairie indépendante... ou en bibliothèque... enfin j'espère.